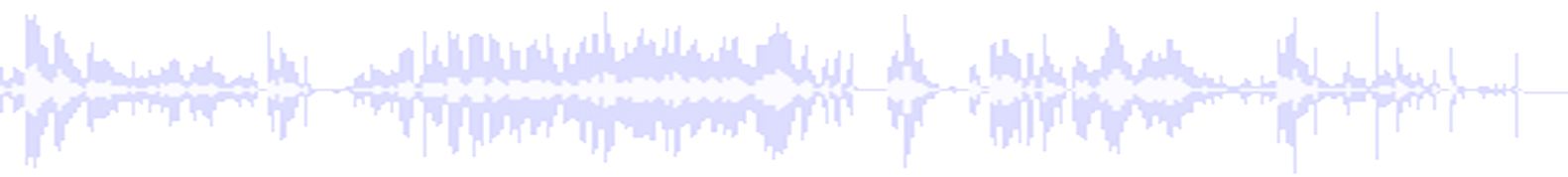Par son intimité avec la nature, Oona évoque le monde des souvenirs, les réminiscences de l’enfance insouciante figurée par le jeu d’une fillette qui prend vie devant la caméra de Gunvor Nelson. Elle fait la rencontre et devient amie avec Steve Reich au San Francisco Mime Troup où, aux côtés de son mari, le cinéaste Robert Nelson, elle participe aux activités artistiques de cette troupe de théâtre contemporain en recherche de nouvelles formes. Dans ce cadre, dès 1964, Steve Reich participe à la réalisation de deux films de Robert Nelson The Plastic Haircut et Oh Dem Watermelons. Dans ce dernier film, il travaille à partir d’un chant sur le thème de la pastèque, un chant populaire qui peu à peu, se transforme en une musique répétitive surprenante pour accompagner les mésaventures d’une pastèque dans ce registre plutôt « humoristique » tout en augurant des polyphonies rythmiques vocales que Steve Reich développera dans les années 70.
Pour en revenir à My Name is Oona, Gunvor Nelson demande donc à Steve Reich, de composer une musique originale qu’il conçoit uniquement à partir d’enregistrement réels recomposés sur bande magnétique.

D’emblée, le film montre une relation audiovisuelle forte. Après le générique où l’on peut lire le titre, « My Name is Oona » sur un fond noir, le silence se prolonge sur les premières images en gros plan d’une fillette blonde qui se dandine. Elle s’adresse en silence à la caméra, c’est à ce moment que la bande son surgit, de manière décalée, pour donner à entendre l’enregistrement d’une fillette qui déclare avec entrain « My Name is Oona ».
.png)
Bien que la voix soit désynchronisée, le lien entre le titre, les premières images et la bande son, loin d’opérer une rupture audiovisuelle, ne fait, au contraire, que la renforcer.
A partir de cet enregistrement étalon, Steve Reich ne conserve finalement que le fragment « Oona ». Isolé, mis en boucle, répété ensuite de manière lancinante se transformant peu à peu du fait du déphasage qui se crée entre les deux magnétophones sur lesquels sont lus en même temps ce même fragment.
Cette manière de débuter sa musique n’est pas sans faire directement référence à ses expérimentations sonores à cette même époque, notamment en ce qui concerne l’emploi de la boucle, puis le déphasage de ces boucles, à l’instar des œuvres composées sur le même principe : It’ Gonna Rain (1965) et Come Out (1966).
Le choix de ces éléments sonore fait écho avec le thème même du film, le souvenir. L’enregistrement fixe l’instant, avant le temps de la réécoute le transforme en souvenir, une réminiscence sonore.
Pour accompagner ces images de souvenirs resurgis, la voix d’une fillette est donc enregistrée, avec la patine particulière du son optique. Peut-être s’agit-il de la voix de l’enfant qui apparaît à l’écran ? peut-être est-ce la voix de Oona, probablement. Qui est Oona ? Le film ne le dit pas. « C’est un souvenir d’un autre temps » dirait Chris Marker… nous ne saurons pas.
Les images offrent un contraste saisissant avec les boucles de la musique où Nelson travaille davantage au niveau de la superposition plutôt que de la répétition. Au début donc, une fillette en gros plan, puis des branches, des feuilles qui ondoient au soleil dans le vent puis, de nouveau, le visage d’une autre jeune fille.
La deuxième partie apparaît avec un nouveau son documentaire, brut, où la voix de la petite fille, encouragée par sa famille, on suppose, annone les jours de la semaine en anglais. Suivent d’autres enregistrements de cette même enfant où elle décline sur tous les tons « My Name is Oona ». Reich procède alors à lente accumulation et une superposition de cette nouvelle manière jusqu’à lentement créer une gigantesque polyphonie réverbérante qui s’intensifie avant de disparaître pour céder délicatement la place au chant d’une berceuse chantée par la voix aimante d’une maman qui fredonne pour son enfant.
Un film fascinant !
My Name is Oona n’est pas une œuvre isolée sur le plan esthétique, on retrouve des principes de composition audiovisuels similaires pour d’autres films expérimentaux de la même période : Berlin Horse (1970) de Malcom LeGrice sur une musique de Brian Eno ou T O U C H I N G de Paul Sharits où se répète inlassablement le mot « destroy ».