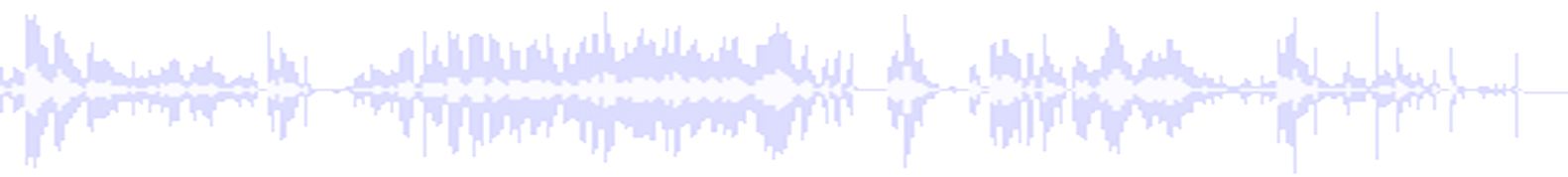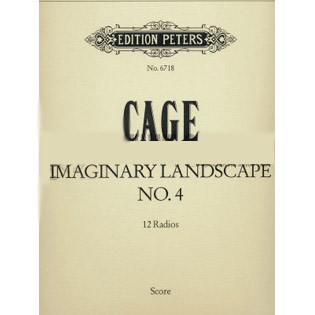
Imaginary Landscape n°4 est dédicacée à Morton Feldman. Vingt-quatre manipulateurs sont nécessaires pour exécuter cette œuvre, soit deux par poste de radio : le premier pour varier les fréquences, le second pour contrôler le volume.
Il semble futile voire contradictoire ici, de vouloir rendre compte de la portée de cette œuvre à travers les instants immuables de l’enregistrement vidéo qui fige l’exécution d’une partition qui, intrinsèquement, cherche le renouvellement permanent et l’indétermination lors de chacune de ses interprétations. Aussi, les enregistrements qui illustrent ce propos ne sont ils pas des contre-exemples de ce que Cage cherchait précisément à approcher : l’indétermination dans l’instant de chacune de ses exécutions ?
Le percussionniste Lê Quan Ninh, spécialiste de l’interprétation de la musique de John Cage, indique que cette œuvre ne doit pas être interprétée de manière frontale mais que les postes de radio doivent au contraire être dispersés dans l’espace. La pièce ne doit pas non plus être dirigée par un chef d’orchestre. Aussi les deux exemples qui suivent semblent très loin d’une représentation idéale.
Extrait d’un article de Catherine De Poortere,
Le poste de radio, dont John Cage extrait du son aléatoire comme il pourrait le faire de n’importe quel objet trouvé, figure au centre de deux performances (1951 et 1956) d’une sobriété presque contemplative, désintéressée. D’un effet vertigineux, ces mises en scène n’en demeurent pas moins simples et ordinaires. Au milieu du siècle des avant-gardes, John Cage n’est pas de ceux qui, sans discernement, exaltent le progrès et cherchent à s’en prévaloir. En art comme dans la société, dans les faits comme dans la vie, l’innovation technique, qu’elle soit littérale, ludique ou même subversive, ne tient lieu ni de style ni de contenu. Aux yeux de cet artiste pluridisciplinaire mais radical, il n’est d’art que vivant, émancipateur, toujours en devenir. L’œuvre ne peut se donner comme forme fixe, forme inerte, sclérosée; c’est là le cadavre de l’art peut-être – si tant est que l’art n’abolisse pas nécessairement sa propre fin.
C’est ainsi que Cage procède : cadrer pour libérer. Les amateurs de notations originales trouveront leur bonheur en examinant les « partitions » de « Radio music » et « Imaginary landscape n°4 », sur lesquelles l’artiste détaille écarts de fréquences, silences et autres spécificités hertziennes, d’abord sur une portée puis directement en chiffres et en traits de façon à ouvrir au maximum le spectre de manœuvre. Ces deux morceaux, qui emploient chacun une dizaine de postes et le double en exécutants, sont voués à être uniques (on ne tient pas compte des enregistrements « historiques », contradiction dans les termes), d’autant que la radio évolue sans cesse, en forme et en contenu. Si la radio n’est guère qu’un objet sonore parmi d’autres pour John Cage, plus encore que le piano arrangé, elle est l’instrument de l’indétermination par excellence. Sa multiplicité reflète la multiplicité de tous, reflète plus encore la multiplicité d’un seul – et parfois même elle paraît porter la gravité de son destin. Unanime et ressemblante, est-elle l’expression de tous ou d’un seul ? Ou, immanence ingrate, ne dévoile-t-elle qu’un visage rassemblé, difforme – son visage arbitraire ?

La radio n’a pas de sens, elle les contient tous, n’en retient aucun. L’ampleur d’un paysage imaginaire est sans limites. À l’écoute, on se trouve d’emblée transporté comme dans un long voyage en voiture. Il arrive toujours un moment où dans la torpeur de la monotonie, on allume distraitement la radio. À tâtons (qu’est-ce qu’on cherche ? qu’est-ce qu’on attend ?), on s’abandonne aux ondes indistinctes, cela peut durer des dizaines de minutes, entre deux villes sur l’autoroute il n’y a pas grand-chose, on passe trop vite d’une chaîne à l’autre, tout est fluide, les parasites collent les bribes de voix, les langues inconnues, les notes de musique, les cris, les rires… La radio est ce médium acousmatique qui ne supprime certaines formes du silence, de la solitude et du vide que pour les remplacer par d’autres, plus insidieuses, plus redoutables, car plus banales… Voilà ce qu’évoquent ces deux morceaux de Cage, ces temps de dérive, ces temps abstraits infiniment creux où, sans se l’avouer, ce qu’on écoute à la radio c’est la radio elle-même, totalité incohérente, continue et discontinue, lugubrement rassurante, berceuse appropriée au demi-sommeil, à la folle rêverie de la pure passivité.