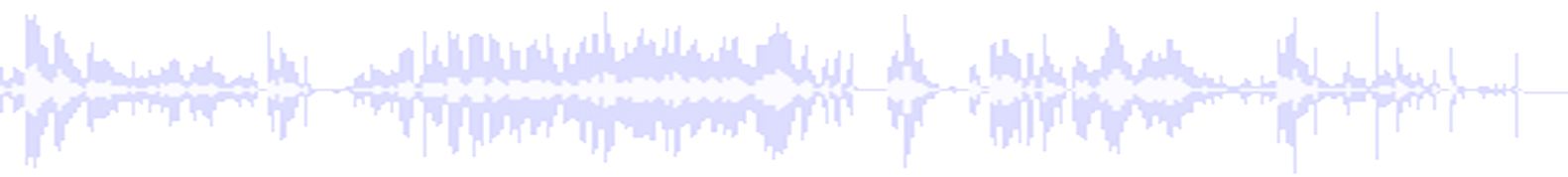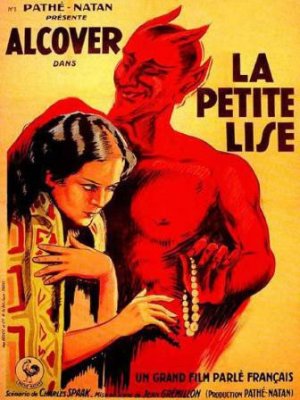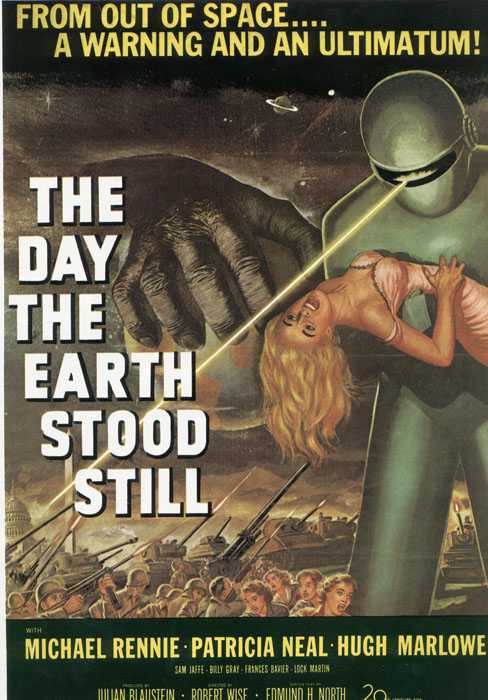Le texte et l'extrait vidéo ci-après documentent l'ouvrage de Philippe Langlois, Les cloches d'Atlantis, musique électroacoustique et cinéma archéologie et histoire d'un art sonore, éditions mf, Paris, 2012.

L’idée de transformation et de double domine dans la mise en scène de ce film et cette option prise depuis l’écriture du scénario guide également tout le travail sur le son, y compris dans le choix des musiques. Dès le générique, il est question de transformer une musique « sacrée » en une musique « profane » : La toccata et fugue en ré mineur de Jean Sébastien Bach, que nous avons l’habitude d’entendre à l’orgue est transcrite pour ensemble symphonique.
Par contraste et pour établir le lien avec cette composition, le plan qui ouvre le film est un panoramique vertical sur des tuyaux d’orgue. Le plan s’achève par des mains jouant sur le clavier. Un Choral de Bach retentit avec cette fois le son de l’instrument sacré. En caméra subjective, sur le pupitre de l’orgue où repose la partition se dessine l’ombre du docteur Jekyll. Nous sommes ici déjà en présence de son double. Le dialogue qui suit avec son valet nous révèle que Jekyll doit sortir. Il suit son valet qui lui donne son manteau – toujours en caméra subjective dans la peau de Jekyll. Nous découvrons alors pour la première fois son visage : Fredric March, qui interprète le rôle titre, se tient devant un miroir pour ajuster son habit. Encore une fois, il s’agit d’une image reflétée, d’un double. Cette ouverture tant soignée sur le plan de la composition visuelle et musicale ne constitue que le prélude à la révélation du double.
La séquence de la métamorphose se déroule évidemment devant un miroir. Pour l’accompagner et la doter d’une totale cohérence audiovisuelle, Mamoulian souhaite obtenir une sonorité inouïe. En mélangeant le son organique des battements du cœur, auquel il ajoute d’autres sons qui viennent parasiter la sonorité initiale, Mamoulian exprime la souffrance de son personnage qui abandonne sans le savoir l’apparence humaine pour laisser libre court à son double bestial. Autrement dit, c’est par le traitement du son que le metteur en scène représente l’abandon de la réalité sonore.
« Pour accompagner la transformation, je voulais un son complètement irréel. Au départ, je souhaitais une pulsation, comme des battements de cœur. Nous avons donc essayé toutes sortes de percussions mais elles sonnaient toutes comme des percussions. Puis, j’ai enregistré mon propre cœur, c’était parfait, merveilleux. Nous avons ensuite enregistré un gong, nous en avons retiré l’impact pour pouvoir renverser la résonance. Finalement, nous avons peint directement sur la piste optique et je crois que c’était la première fois que quelqu’un utilisait le son synthétique de cette manière, en travaillant à partir de la lumière du son ».